CHAPITRE 1. CONDAMNÉ PAR LE DOUTE, IMMOBILE ET CRAINTIF, JE SUIS COMME MON PEUPLE, INDÉCIS ET RÊVEUR.Je suis le fils d'un ancien oligarque russe. Pendant très longtemps, il a prospéré. Pendant très longtemps, il s'est assis sur la vie des gens pour amasser une somme rondelette. A l'époque, je ne savais rien de tout cela. Mon père était juste un homme occupé, qui parfois rentrait avec de superbes femmes pendant que ma mère s'enfermait dans la salle de bain. Il était gros, fat et vain. Un véritable stéréotype se bourrant de caviar jusqu'à plus faim et se délectant de la plus exquise des vodkas. Je le craignais, tout en ignorant complètement qui il était. Toujours absent ou au milieu d'un groupe d'hommes tout aussi gros que lui. Dans cette masse de chair informe, je ne le reconnaissais pas. Tous riaient, le plus fort possible. Le rire gras était synonyme de richesse et le tour de taille, d'opulence. Ils fumaient d'énormes cigares, la pièce s'envahissant de cette brume épaisse et assassine. L'un d'entre eux m'en a un jour fourré un dans la bouche et m'a bouché le nez pour que j'aspire le plus fort possible. J'avais neuf ans, j'ai vomis sur le sol. Tous s'esclaffèrent, encore, toujours ces rires... Mon père n'intervint pas. A travers le miroir souillé de mes larmes je les percevais tous comme d'énormes hippopotames, masses noires secouées par le rire, la bouche grande ouverte. Je craignais que leurs bouches gigantesques ne m'aspirent et m'entraîne au fond des ténèbres pour ne plus jamais me laisser sortir. Je restais longtemps à quatre pattes sur le sol, comme un animal attendant la terrible seringue qui enfin mettra fin à ses souffrances. Au loin, j'apercevais le visage de ma mère, empli de larmes. Elle n'avait pas le droit. Pas le droit de traverser cette muraille de chairs. Je sentais son angoisse et le combat qui était en train d'être mené à l'intérieur d'elle. Je fermais les yeux. La voir pleurer m'était insupportable. Elle était la seule personne qui m'aimait, oui la seule. Pauvre, pauvre femme. Soudain, je me sentis décoller du sol. C'était elle, je reconnaîtrais son odeur fleurie au milieu d'une gigantesque décharge. En ce monde, c'est ce qu'elle était. Une fleur parmi les détritus. L'un d'entre eux, mon père, se leva alors, furibond. Sa terreur était palpable, je pouvais sentir son cœur cogner dans sa poitrine. A peine eus-je le temps de tourner la tête qu'un poing vengeur s'écrasa sur le visage si doux de ma génitrice. Elle vacilla, sans jamais me lâcher malgré sa douleur. Les autres oligarques souriaient. Ces êtres étaient malsains, corrompus. La souffrance d'une femme leur plaisait au plus au point. Mes larmes continuèrent à couler sur la peau douce de ma mère. Mon père l'attrapa par ses beaux et grands cheveux blonds et la tira avec force fureur vers la cuisine. Il ne disait rien, mais on pouvait sentir sa haine envers elle. D'un geste rageur, il la projeta contre le buffet en fonte. J'entendis un bruit sourd. Ce fut son crâne qui venait de frapper de plein fouet le meuble assassin. Ses yeux se révulsèrent. Elle ne se releva pas. Malgré tout, je pouvais sentir la vie qui résistait à tout prix en elle. Ses bras me serraient toujours, n'abandonnant pas un centimètre à son ennemi. Elle me murmura que tout ira bien. J'étais persuadé qu'elle allait mourir. Peut-être était-ce ce qu'elle souhaitait. Mais c'était une femme forte, élevée durement, qui avait appris à se battre dans ce monde d'hommes. Elle resta allongée pendant quelques heures. Au loin, des rires retentissaient. Quand elle ouvrit les yeux, il était cinq heures du matin. Dans la cuisine, il faisait noir comme dans un four. Elle me caressa les cheveux et murmura : "Il faut que nous partions." Je l'aurais suivie jusqu'au bout du monde. Elle grimpa les marches quatre à quatre, comme prise d'une énergie nouvelle, bien que je pouvais apercevoir ses cheveux collés par le sang à certains endroits. Elle redescendit aussi vite qu'elle était montée, avec quelques valises. Elle me fit un clin d’œil presque imperceptible. Elle semblait avoir prévu ce moment depuis longtemps déjà. Elle m'expliqua que nous allions retourner vers sa terre de naissance, la Roumanie. A cette époque, tout cela faisait partie d'un même tout : l'URSS. Malgré tout, le cœur de ma mère restait fortement attaché à ce pays. Peut-être pensait-elle à cette époque où elle était tombée amoureuse de mon père, encore jeune entrepreneur. Lorsque tout était possible. Je me rappelle de ce long trajet, entre wagons surpeuplés et voitures inquiétantes. Pour me rassurer, ma mère chantait une ancienne litanie dans sa langue maternelle. Je m'en souviens encore. Chaque fois que j'avais peur, sa voix résonnait près de moi, pure comme le cristal. Nous nous sommes installés dans une vieille maison en bois, toute petite, mais dont j'appréciais le dénuement. Après tant d'opulence, je me sentais à mon aise dans cet univers épuré. Quelques années plus tard, l'URSS s'effondra, le Mur avait été détruit des deux côtés à grand coups de marteau et d'espoir. Je l'avais appris dans le journal; bien que j'étais beaucoup trop jeune pour en comprendre tous les enjeux, au fond de moi j'ai su que les choses seraient différentes. Ceausescu était mort exécuté et le pays semblait revivre d'un souffle nouveau. Un jour, ma mère et moi reçûmes une lettre, nous invitant à nous rendre chez un notaire, en Russie. Nous ignorions quelle en était la raison, mais je sentais que ma mère avait son idée sur la question. Nous voyageâmes donc vers la mère Russie, qui semblait à l'époque exhaler de longs soupirs d'agonie. Nous rencontrâmes le notaire, un homme propre sur lui, toujours debout malgré l'agenouillement de son pays. Il nous informa que mon père était mort, retrouvé une balle dans la tête. Nous ignorions si ce fut un suicide ou une partie de roulette ayant mal tourné. Peut-être les deux, qui sait. Son empire s'était effondré. Malgré tout, il lui restait de l'argent. Beaucoup d'argent, caché sur divers comptes dans plusieurs pays. Selon l'homme bien habillé, il nous revenait de droit. Le visage de ma mère s'éclaira et elle me lança un regard qui voulait tout dire : pour moi, elle avait de très grands projets.
CHAPITRE 2. JE SUIS LE TENEBREUX LE VEUF L'INCONSOLE LE PRINCE D'AQUITAINE A LA TOUR ABOLIELes années suivantes furent synonymes de privations en tout genre et de rationnement de la nourriture. Le pays souffrait encore de son indépendance nouvelle et les gens ne savaient que très peu composer avec le nouveau capitalisme. C'est encore le cas aujourd'hui. Au fond de moi, je me demandais pourquoi nous n'utilisions pas l'argent de mon père, qui dormait bien au chaud sur un compte, fructifiant chaque année. Nous pourrions vivre comme ceux d'Europe de l'ouest et acheter tout ce qui nous plairait. Mais, toujours, ma mère refusait, la mine distraite. Tous les soirs elle rentrait épuisée de sa journée passée dans les champs ou à l'usine. Sa peau si blanche avait pris un teint hâlé et ses beaux cheveux d'autrefois étaient maintenant secs et ternes. Cela faisait longtemps qu'elle avait renoncé aux shampoings coûteux et se les nettoyait avec une base d’œufs et d'huile. Le soir, nous mangions une soupe de légumes bouillis, de la viande dans les jours fastes et le lendemain du goulasch, les restes. C'était mon plat préféré, car je n'arrivais pas à profiter de la viande fraîche : je l'engloutissais beaucoup trop vite. Alors que le lendemain, je savais qu'il en restait peu et je me forçais à la savourer, car je gardais en mémoire que je n'en aurais de nouveau que dans très longtemps. Ma mère faisait tout pour que je sois le meilleur en classe et se privait de nourriture pour me payer les meilleures écoles et les meilleurs professeurs. La plupart de ses vêtements se transformaient en haillons, qu'elle rafistolait à l'aide de morceaux de tissus jetés à son travail. Elle ressemblait à un Arlequin, tant ses habits regorgeaient de différentes couleurs. Elle souriait souvent, mais je savais qu'au fond sa tristesse était infinie. Elle était si jeune et pourtant déjà, son visage se creusait à grands coups de burin. Elle avait renoncé à être belle, à rencontrer quelqu'un d'autre. Elle n'existait que par mon intermédiaire, que par ma réussite. J'étais tout ce qui lui restait. Malgré tout, c'était une femme d'honneur et même dans la misère la plus noire, sa tête serait restée droite. Son plus grand désir était de me tenir loin du besoin et surtout de me pousser vers le sommet, quitte à indéniablement s'enfoncer elle-même. Elle voulait m'empêcher d'abandonner les études et d'aller travailler aux champs, comme le faisaient beaucoup de jeunes de mon âge pour subvenir aux besoins de leur famille. Nous étions très mal vus et haïs de tous. Les autres me trouvaient privilégié, vantard, alors que jamais je ne sortais la tête de mes livres. Je ne leur avais jamais adressé la parole et pourtant il prenaient un malin plaisir à jeter mes livres chers dans la boue. Je rentrais alors dans une sombre colère et me battait contre eux. Dans ces moments, je devais ressembler à mon père. Lorsque ma mère l'apprenait, elle se mettait à pleurer. Elle ne voulait pas me voir devenir un chien fou, incapable de contenir ses pulsions. Elle s'enfermait alors et nettoyait le livre soigneusement, pages par pages, avec un chiffon mais sans doute également avec ses larmes. Au fil de mon adolescence, j'ai construit ma personnalité et je suis devenu fort. Malheureusement, je suis devenu un salaud. Principalement avec les femmes. Moi qui avait assisté toute ma vie à la détresse et en même temps à la force de ma mère, je ressentais pourtant le besoin de consommer pour ensuite jeter. Toutes ces midinettes me dégoûtaient. Ma mère m'avait donné une image tellement forte, tellement inaltérable que toutes les autres me semblaient faibles, insolentes et capricieuses. Je tenais fort évidemment ma génitrice loin de toutes ces histoires. Au lycée, elle ne savait plus rien de moi. Je restais près d'elle mais mon esprit s'éloignait. J'avais besoin de vivre ma propre vie, elle m'y poussait. Un jour, elle m'a définitivement jeté hors du nid. Je m'en rappellerais toujours, la journée était ensoleillée. Je profitais de l'oisiveté des vacances en sortant marcher dehors, profitant de la vie malgré le peu d'argent disponible. Ne m'attendant à rien, je poussais la porte. Elle s'avérait bloquée par quelque chose. Je poussais avec d'autant plus d'ardeur, avant de trébucher et de tomber lourdement au sol. La maison semblait vide. Je passais la tête de l'autre côté de la porte, afin de m'enquérir de ce qui a ainsi pu bloquer ma course. Sous mes yeux, une valise remplie accompagnée d'une boîte et d'un mot. La valise était pleine d'affaires, fraîchement repassées desquelles émanait une odeur fleurie. Dans la boîte, je trouvais plusieurs papiers, des billets de trains, une carte bleue anglaise, un visa, un passeport ainsi que différents feuillets administratifs. Sur le mot je reconnaissais la douce écriture de ma mère. Elle avait fait parvenir mon dossier à l'université d'Oxford qui avait accepté ma candidature en tant qu'étudiant étranger. Je comprenais alors tout. Pourquoi l'argent n'avait jamais été utilisé, pourquoi elle me poussait tant à travailler.... Sans me le dire, du bout de ses longues aiguilles, ma mère avait cousu le meilleur des avenirs sous mes pas. Le train partait bientôt, le papier disait de ne pas prendre le temps de lui dire au revoir. Juste de partir, vite. En bas, elle avait écrit qu'elle penserait toujours à moi et qu'au fond de son cœur, toujours je serais présent. Les sentiments se mélangèrent dans mon crâne, mais je ne pouvais tarder plus longtemps. Le voyage fut long. A mesure que mon voyage avançait, je voyais les gares se moderniser, les villes s'agrandir, les magasins se multiplier. Je parlais un anglais irréprochable et personne n'avait de mal à me comprendre, malgré mon fort accent. Je me perdais régulièrement dans ces gares gigantesques, où tous se bousculaient. Après un court trajet en ferry et quelques correspondances de bus, j'arrivais enfin à Oxford. Cette ville est magnifique et respire fortement l'esprit anglais avec des magasins aux couleurs d'Alice, blottie dans son pays des merveilles, une bibliothèque gigantesque qui bientôt m'ouvrira ses portes et des université monumentales, semblables à de gigantesques manoirs. Je craignais de ne pas me sentir à me place au milieu de tous ces gens, riches pour la plupart, ou très intelligents. Mais contre toute attente, je fus rapidement intégré. Mes origines et mon parcours me conféraient un côté exotique, surtout pour les étudiants s'intéressant à la Guerre Froide ou à l'histoire de l'Europe de l'Est. Mes notes étaient excellentes et je me construisis rapidement une petite réputation. Malgré mon comportement ignoble envers les femmes et ce côté manipulateur et débrouillard qui ne m'a jamais quitté, je n'ai jamais réellement ressenti de haine générale à mon égard. J'étais très apprécié et j'avais l'impression que personne ne pouvait résister à ma compagnie. Peut-être étais-je cette sorte de fruit interdit. Je faisais du mal, beaucoup de mal, mais on en redemandait, aveuglément. Mes études se poursuivirent tranquillement et j'obtins bientôt mon doctorat de sciences économiques, avec le droit comme spécialité. Je ne me destinais pourtant pas à un métier dans ce secteur. Je voulais enseigner. Grâce à lui. A Oxford, j'ai trouvé mon ange gardien, celui que je considère aujourd'hui comme mon véritable père. Mon professeur de droit. Un homme athlétique, au teint frais malgré les rides, à l'esprit vif malgré l'âge. C'était un anglais pur souche, provenant d'une famille aisée mais ne s'étant jamais laissé corrompre. Enseigner était sa passion. Je buvais avidement ses paroles. Souvent, le soir, nous allions prendre un whisky chez lui et nous conversations duraient toute la nuit. Nous partagions nos idées et lui me faisait cadeau de sa sagesse. C'est grâce à lui que je suis devenu professeur à Harvard, grâce à ses relations. C'est lui qui m'a soutenu lorsque ma mère est morte de la tuberculose. Il s'inquiétait toujours pour moi et me reprochait mon comportement parfois infect. Comme un vrai père. Malheureusement, comme tous les gens que j'ai jamais aimé, il trépassa peu de temps après la réponse positive d'Harvard à mon égard. Je me suis promis de porter son drapeau jusqu'en Amérique et peut-être un jour, qui sait, d'inspirer quelqu'un à mon tour.
AUJOURD'HUI TU MARCHES DANS PARIS ET LES FEMMES SONT ENSANGLANTEES. C'ETAIT ET JE VOUDRAIS NE PAS M'EN SOUVENIR C'ETAIT AU DECLIN DE LA BEAUTE.
FIN
 Accueil
Accueil
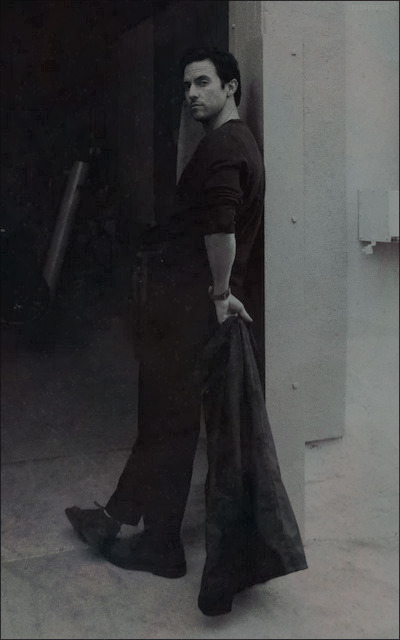









 Bon courage pour la rédaction de ta fiche !
Bon courage pour la rédaction de ta fiche ! 







 Bienvenuuuuuue sur le forum
Bienvenuuuuuue sur le forum 



