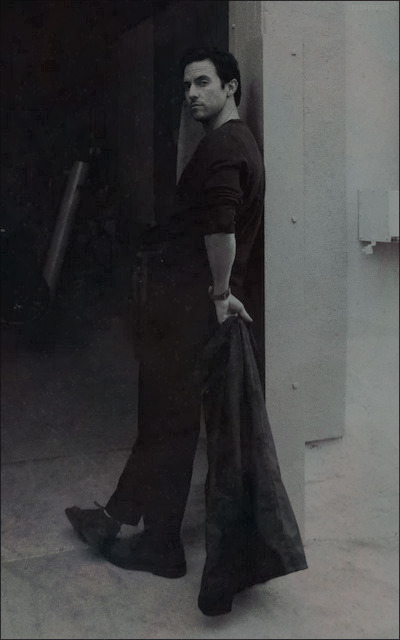J'ai jamais sus ce qui m’avait poussé à devenir ce que je suis devenue, surement est-ce une suite de causes à effets qui me poussa à rejoindre la part la plus obscure de moi-même pour y laisser fleurir ma noirceur… Tout est-il que me voilà aujourd’hui, un beau dimanche de septembre, attendant la montée de ma dose. Une dose mortelle, qui me permettra d’oublier le passé et de quitter cette souffrance continue que je suis forcée de vivre. Lentement j’ai travaillé à un processus d’autodestruction. J’ai fait des choix sans jamais vraiment réfléchir, et souvent mes décisions sont revenues m’exploser à la gueule. Sans aucune conduite j’ai fait tomber mon esprit dans les mailles d’un piège que j’ai moi-même construit. Et de façon aussi minutieuse qu’incontrôlé, mon corps s’est conforté dans un profond déséquilibre tandis que ma tête tentait péniblement de rester à la surface. J’ai toujours admiré ces oiseaux qui peuvent voler si haut sans que jamais leurs petites pattes ne se posent sur la dure croute terrestre. J’ai eu la prétention de m’en croire capable à mon tour. J’avais tort.
« Putain, fais chier ! » c’est à coup de ce genre de phrases vides de tout qu’on se disait que ça irais mieux. On s’défonçait, en espérant que nos rêves se réaliseraient. L’envie, l’espoir, c’était ça la drogue. On avait le pouvoir de s’imaginer déjà au plus haut alors que même le plus bas nous était à peine abordable. Effrayés mais courageux, on aurait fait n’importe quoi pour avoir le peu que l’on demandait, le peu que l'on espérait. Au fond, c’est pas de tenter quelque chose qui nous aurait tués. On profitait seulement de ce qu’on avait déjà. Le minimalisme, l’instant, le présent, l’eau ruisselante sur nos corps, la chaleur, le silence, son corps contre le mien, nos salives qui se mélangent, l’ombre de chacun qui piétinait celle de l’autre, c’était ça qui nous gardait en vie. L’avenir, le grand, le remarquable, on en avait pas besoin. La force qu’on s’apportait l’un à l’autre. C’est ce qui nous poussait à croire qu’on n’allait pas mourir ce soir. Ce qui nous poussait à croire qu’on n’allait jamais mourir, et que, naïvement, on était invincibles. Quand on s’éloignait, et on savait bien qu’on n’irait jamais loin, mais aussi loin que l’on partait, on se rapprochait de ce qui, au final, nous était devenu indispensable. Bouffés par ce qui nous effrayait tant, on était pourtant prêt à se laisser dévorer pour y rester. Chanter sur le même accord, partager le même plancher, la même eau qui coulait sur nos corps, la même vapeur dans nos cerveaux embrumés. On y prenait goût. La chute s’avérait chaque fois plus cruelle. Nous étions fou l’un de l’autre, et du haut de nos dix-huit ans nous étions persuadés que le monde entier nous appartenait et que jamais nous ne pourrions tomber. Quelle douce illusion. Une fois arrivé au sommet, on ne peut plus que redescendre, ou apprendre à voler. Nous n’avions pas d’ailes. Je crois que jamais nous n'en n'avions eu. Dans un autre monde peut-être que tout aurait été différent. Peut-être que nous serions heureux. Qu'il serait encore là. Tout aurait pu être tellement différent. Nous aurions habité dans une belle maison blanche, avec des volets bleus. Il se serait agenouillé devant moi, et j'aurais descendu l'allée, rayonnante dans ma belle robe blanche, sous le regard radieux de mes parents. Un happy end joyeux et coloré, comme dans ces vieux films que nous regardions en entrant en douce dans le vieux cinéma en bas de la rue. Mais dans la vraie vie ça ne finis jamais comme dans les films. Et je ne suis ni blonde ni chanceuse. Alors j'ai regardé mon semblant de bonheur voler en éclat, s'étalent sur le sol comme un miroir que nous aurions nous-même brisé. La dernière chose dont je me souvient de cette nuit-là, c'est le pin-pon assourdissant de l'ambulance, et ta main glacée dans la mienne. Tes doigts qui se raidissaient lentement. Tu m'avais pourtant promis qu'on serait toujours ensemble, mais t'as menti, et tu m'a laissé tomber. T'es parti sans moi, et j'ai rien fait. Qu'est ce que j'aurai pu faire de toute façon ? Il y a des gens qui naissent sous une bonne étoile. Ma mère m'a dit un jour que nous avions tous un ange gardien, désigné par dieu le jour de notre naissance, et qu'il nous accompagnerait partout et nous protégerais. Ils devaient être bourrés le jour de ma naissance, parce que moi, j'ai jamais eu d'ange gardien..
Je suis née le premier avril 1992, même le jour de ma naissance sonne comme une mauvaise blague.ça s'est fait dans un appartement miteux du Bronx. Maman était seule à la maison ce jour-là. Elle a tout juste pu appeler une sage-femme pour l'aider à me faire sortir de son ventre. Dès mon premier cris, j'étais déjà dans la merde. C'est elle qui a choisi mes prénoms, Papa n'est arrivé que bien plus tard dans la soirée. Mes parents avaient quitté leur Turquie natale depuis deux ans, et la vie à New York ne s'était pas avéré aussi belle et prometteuse qu'elle ne leur avait semblé. Papa travaillait dans une usine de ciment et maman faisait le ménage dans un petit hôtel au coin de la rue, ça suffisait tout juste à payer le loyer d'un petit T2 tout en haut d'un immeuble qui sentait l'urine et le moisit, mais c'était toujours mieux que rien. Être turc quand on vit dans le Bronx ne facilite pas vraiment l’intégration, et durant mon enfance je n'ai eu que très peu d'amis. Je passais de nombreuse heures à dessiner seule dans l'appartement désert, mes parents ne rentraient que tard le soir. Si je n'avais pas eu ma boite de peinture, je ne sais pas comment j'aurais pu supporter cette solitude constante.
A l'école c'était pas facile. Je n'était ni blanche, ni noire, et plutôt chétive. Il ne leur a pas fallu longtemps pour me prendre pour cible. Des coups, des mauvaises blagues, j'en ai eu plus que ma part à cette époque. Mais je ne me lamente pas dessus. C'est vrais, j'en ai bavé, mais j'ai appris à faire face, j'ai changé.
Le changement en question s'est fait à mon entrée au collège. Le premier jours mon père m'a regardé droit dans les yeux, en me disant de venir une fille bien, me promettant de me trouver une belle vie. Il était très fier de moi. S'il me voyait maintenant je crois qu'il me tournerait simplement le dos. Ou qu'il éclaterait en sanglot devant l'épave que je suis devenue. Mais si ma vie a pris ce tournant, c'est principalement ou à cause des rencontres faites à cette époque-là. Une en particulier. J'avais 11 ans, et j'entrais en première année. Elle était en troisième année, et je ne sais pas trop pourquoi, mais elle a jeté son dévolu sur moi. Jane. Elle était grande, très blonde et portait des jeans troués, je l'ai tout de suite admiré. Jane était forte, personne ne lui marchait sr les pieds, et les malheureux qui avaient le malheur de l'insulter finissaient toujours la tête dans la cuvette des chiottes. Elle était toujours entourée de sa petite cour, sa bande. Dont je faisait parti. mais j'avais d'autre ambition, je voulais devenir plus, je voulais devenir son amie, la seule, le vraie. Je voulais non seulement lui ressembler, mais devenir son égale. J'avais 12 ans lorsque j'ai fais mon premier tatouage. Je me suis mise à fumer, d'abord des cigarettes, puis bien vite les pétard ont pris leur place. J'ai appris à m'affirmer, à montrer que j'étais "une dure", a tabasser ceux qui ne nous respectaient pas. A montrer ma force. C'est aussi à cette époque que le nom Jo est venu, personne ne m'a plus jamais appelé par mon prénom depuis. Très peu de gens le connaissent, je suis Jo. Jo la junkie, Jo qui taille des pipes dans le toilettes, échange d'un fix. Jo qui traine trop souvent dehors. Jo qui danse nue dans sa chambre. Jo qui peint des choses magnifique quand tout vas mal. Cette fille-là, c'est Jo. C'est ce que je suis devenue.
C'est au lycée que j'ai découvert l'héroïne. J'ai commencé par sniffer du speed. Ça coute pas cher le speed, mais ça suffit pas vraiment. C'était sympa, mais pas suffisant. Je voulais rêver, voyager, sentir le monde décoller autour de moi. Je voulais quitter ces hlm puant et ces rues minables. Je voulais m'envoler. J'ai alors fais la seconde rencontre qui a changé ma vie. Surement la plus importante de toutes. Il s’appelait Eddie. Il était très beau, avec des épaules large et le corps couvert de ces petits dessins que j'aimais tant. Il trainait dans les boites et clubs de hip hop ou je passait mes nuits. Tout le monde le connaissait. Tout le monde le respectait. Il fait dire qu'avec un flingue dans la ceinture, on vous respecte en général. Il vendait de la drogue, on le savait tous, il bossait pour les blacks. Toute la bande m'avait déconseillé d'y aller, ces types-là sont des malades, c'est dangereux. Mais j'en avait rien à foutre. J'avais 16 ans, il en avait 20, et j'ai foncé droit dessus.
J'ai compensé mon manque de "pulpausité" par une danse terriblement sexy, et je n'ai pas eu à attendre longtemps avant de sentir son corps dans mon dos, ses mains sur mes bras. "Hey princesse, d'où tu viens ?" furent les premiers mots qu'il m'adressa. Il chuchotant dans mon oreille, son torse contre mon dos, dansant lentement, m’accompagnant des tous mes mouvement. J'ai su à cet instant que je ne pourrais plus jamais me passer de lui. Nous avons vaguement discuté, puis je l'ai accompagné chez lui. Nous avons fait l'amour. Plusieurs fois. C'était la première fois pour moi, ce fut magique. C'est comme si nos corps étaient connecté, comme si nous étions fait pour nous "emboiter" de la sorte. Nous étions fait l'un pour l'autre, c'était une évidence. Nous avons passé la journée du lendemain tous les deux, nus dans son appartement. Il n'avait pas grand-chose, mais quand on vit dans l'Bronx c'est pas parce qu'on a d'la thune. Le soir, Eddie m'a proposé de partir, il avait besoin de "s'envoler", et c'était pas un truc pour les gamines. Ce soir-là je suis partie terriblement vexée. Arrivée chez mes parents, j'ai beaucoup pleuré. J'avais cru en lui, en ses promesse, en la chaleur douce de ses mains sur mon corps. Il s'était bien foutu de moi.
Je ne l'ai pas revu pendant trois semaines, puis un jour, en sortant du lycée, Une main m'a attrapé l'épaule. Je me suis retourné prête à envoyer mon poing serré dans la gueule de celui qui avait osé, mais j'ai stoppé mon geste en vol lorsque j'ai vu le visage amusé d'Eddie face au mien.
"Jo, j'ai pensé à toi. J’arrête pas en fait." furent les mots qui me convainquirent à le suivre. Encore une fois, j'échouais dans cet appartement minable qu'il occupait. Pourtant ce soir-là il ne m'a pas mise dehors. Il m'a juste dit qu'il allait s'envoyer une balle, et m'a demandé de ne pas regarder. J'ai refusé. Je l'ai regardé préparer sa dose, chauffer le liquide dans une petit cuillère, puis serrer son brad avec sa ceinture. Je l'ai arrêté. "moi d'abord" ai-je simplement dit. J'allais enfin pouvoir découvrir cette magie dont tous le monde parlait, celle que tu t’envoie dans les veines avec un aiguille. Ce soir-là j'ai pris mon premier shoot, le premier d'une longue série. C'est aussi ce soir-là qu'Eddie et moi avons décider de rester ensemble. Peut nous importait l'avenir, nous étions fais pour avancer à deux.
Je suis tout de même retournée au lycée, mais mes absences se faisaient de plus en plus régulière, et si je n'avait pas été si prometteuse avec ma peinture, je pense qu'ils m'auraient tout simplement éjectée depuis un bon moment.
J'ai quitté l'appartement de mes parents six mois plus tard. Eddie vendait sa came, pour pouvoir acheter la notre, mais vint le moment ou ce ne fut plus suffisant. C'est naturellement qu'il m'a accompagnée sur les bords d'autoroutes. Il surveillait, et je faisait ce que j'avais à faire. Ce n'était pas vraiment difficile, juste un peu dégoutant. Mais nous avions besoin de cette thune. Besoin de la came. Pourtant d'une certaine façon nous étions heureux. Nous étions ensemble et c'est tout ce qui comptait. J'ai perdu tous mes amis de vue, j'ai perdu aussi pas mal de kilos. Manger était devenu secondaire, la came passait avant.
Nous nous promettions de rester toujours tous les deux, puis ça, la came, le studio minable, c'était que provisoire, on allait arrêter, acheter une belle maison, blanche avec des volets bleus, et un grand jardin dont Eddie tondrait le gazon. Nous aurions deux enfants, pet-être même trois, qui riraient avec nous autour du barbecue, et un chiens pour tenir compagnie. Il irait travailler et je l'attendrait ici, avec les enfants. Nous serions clean, beau et amoureux. Mais ce n'était que des promesses en l'air. Nous étions trop défoncés pour comprendre ce que nous faisions. Puis vint ce dimanche, ce terrible dimanche. Le soleil brillait haut dans le ciel. Eddie venait de m'injecter ma dose, il préparait la sienne. Je me suis allongée sur le matelas défoncé, dont les ressort me rentraient dans le dos, et il a fini par me rejoindre. Il me serait dans ses bras, ses bras chaud et doux. Je me blottissait contre lui et fermait les yeux. la dose était forte, l'héroïne devait être très pure pour faire cet effet. En tant normal je me serais levé d'un bon pour appeler le SAMU, mais j'étais défoncée, et plus rien ne m'importait. Je sombrais dans un état de plus en plus végétatif lorsque le pin-pon assourdissant de l'ambulance s'est mis à résonner autour de nous. Les bras d'Eddie avaient perdu leur chaleur, se refroidissant peut à peu. Ses mains devenaient de plus en plus rigide, et sa peau autrefois si belle prenait des reflets violacé. Je me retournait péniblement pour découvrir ses yeux grand ouverts sur le plafond. Pourtant il n'était pas réveillé. Des bras inconnus m'ont séparé de cet homme que j'aimais tant, et je n'arrivait même pas à articuler un mot pour leur dire de nous laisser. Il m'ont arraché à lui, je voulais les envoyer balader, personne n'avait le droit de nous séparer, mais je ne pouvais pas. Ils m'ont mise sur ce lit et je les ai vus refermer une housse sur la tête d'Eddie avant de sombrer totalement dans l’obscurité. Ce n'est que plusieurs heures plus tard que j'ai ouvert les yeux à l'hopital. Ma remière phrase fut pour lui "Eddie, je veux voir Eddie !" Mais c'est la main de ma mère qui s'est posé sur ma joue. Elle pleurait en regardant mon visage maigre et usé. "Eddie ne viendra plus kýr çiçeði".
Je n'ai pas assisté à l'enterrement, on ne m'a pas laissé y aller. Le père d'Eddie a fais comprendre au mien que je n'y était pas souhaité. Il a aussi donné une grande somme d'argent pour me tenir à l'écart de leur vie. Avec cet argent on m'a alors envoyée en désintox. J'avais presque dix-huit ans. Je suis restée cinq mois dans le centre, cinq mois qui furent terrible. le sevrage, et les crises de manque ont bien faillis me tuer, mais j'en suis sortie. j'étais clean. C'est à cette époque que l'on m'a proposé une bourse pour Havard, pour étudier la peinture. Mon talent était alors indéniable sellons les recruteurs. Je ne pouvait pas rester ici, le fantôme d'Eddie était partout, et je savais très bien qu'ici personne ne me laisserais m'en sortir, je finirais tôt ou tard par rechuter. J'ai alors saisis cette chance qui se présentait à moi, et je suis partie.
Je crois que les Junkies ont un genre de radar pour repérer ceux qui l'ont été, parce que même ici ils ont finis par me rattraper. J'ai tenus six mois, six mois sans rien prendre, sans même fumer un pétard, puis j'ai craqué. Je me suis acheté une seringue et j'ai retrouvé ma vielle amie avec un sourire immense. Le bonheur. La plénitude.
Je me fixe maintenant tous les jours, je ne m'en sortirais surement jamais. Mes parents ont décidé de me laisser vivre ma vie, je ne sais pas si cela vient d'eux ou de moi, mais le résultat est le même, je n'ai plus de nouvelles, eux non plus. Je suce des bites dans les toilettes pour pouvoir payer ma dose, parce qu'un travail serait trop fatiguant, inutile. Je gagne juste ce qu'il me faut. Oui je suis une trainé, le genre de fille qui vous fait pitié, une épave. Je me prostitue sans le moindre scrupule, et j'enfonce cette aiguille dans mon bras avec une fébrilité inquiétante. Mais maintenant j'ai des amis, et je ferais tout pour leur éviter de finir comme moi. J'ai tout de même une peu repris le dessus, je suis consciente de ma vie, du moins la plupart du temps. J'ai toujours au fond de moi cet éspoir de m'en sortir, d'être un jours libre et heureuse, mais je n'ai plus la force. Je ne parle pas de mon passé , ou alors très peu, mais j’essaie de vivre. De tenir debout. Qui sait peut-être qu'un jours un nouveau prince entrera dans ma vie, et qu'il m'arrachera à cette conditions de sous-merde...
 Accueil
Accueil